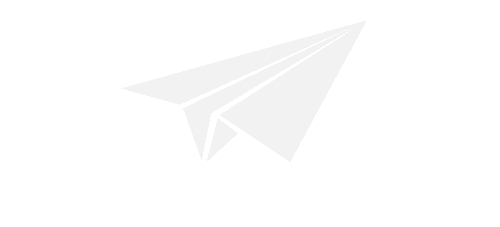Un déficit structurel désormais visible
Dans une économie aussi résiliente que la Suisse, la pénurie de main-d’œuvre n’est plus une simple conjoncture, mais un phénomène durable. Le vieillissement de la population crée un décalage entre départs à la retraite et nouvelles entrées sur le marché. La pandémie a encore réduit la mobilité des talents et ralenti les recrutements internationaux. En parallèle, la croissance soutenue des dernières décennies a intensifié la demande de compétences qualifiées.
Selon l’Union patronale suisse, le pays emploie environ 30% de personnes en plus qu’il y a vingt ans, ce qui étire la capacité du système à trouver les bons profils. Ce dynamisme est une force, mais il oblige à repenser la manière d’attirer et d’intégrer des talents. La pression est structurelle, et les réponses doivent être durables autant qu’opérationnelles rapidement.
Des secteurs sous tension
Plus de 100 000 postes restent vacants, dont une part importante dans la santé et la restauration. Les hôpitaux manquent d’infirmiers, les EMS recherchent des compétences de soins, et l’hôtellerie peine à stabiliser ses équipes. S’ajoutent l’ingénierie, l’IT et la construction, où les projets s’accumulent plus vite que les candidats. Ce déficit freine des investissements, dégrade la qualité de service et accroît la charge sur les équipes restantes.
Chaque poste non pourvu retarde une innovation, prolonge une liste d’attente médicale et fragilise une chaîne opérationnelle. La compétitivité repose sur la disponibilité des bonnes compétences, au bon moment et au bon endroit. Quand la demande dépasse l’offre locale, l’ouverture devient un levier plus qu’une simple option politique.
Pourquoi l’apport international compte
Les professionnels venus de l’étranger apportent des savoir-faire rares et des perspectives nouvelles. Leur présence comble des lacunes critiques, accélère les transferts de compétences et soutient l’innovation. Dans la santé, ils stabilisent les équipes 24/7; dans l’ingénierie, ils fluidifient la gestion de projets complexes. Leur contribution renforce les chaînes de valeur, du laboratoire à la production, jusqu’au service au client.
La Suisse bénéficie aussi de la proximité des travailleurs frontaliers, qui sécurisent des activités quotidiennes essentielles. Cette réalité n’est ni un pis-aller ni une dépendance subie, mais un choix stratégique d’insertion dans un marché du travail européen. Plus le pays accueille et fidélise ces talents, plus son écosystème reste agile et compétitif.
Lever les freins à l’intégration
Pour répondre vite et bien, il faut des procédures claires, des parcours d’intégration efficaces et une vision partagée entre acteurs publics et privés. Les leviers à actionner sont connus et déjà largement documentés.
- Reconnaissance des diplômes simplifiée, avec délais réduits et critères transparents.
- Allégement administratif pour les permis et l’embauche, via des guichets numériques.
- Formation linguistique accélérée et modules d’acculturation professionnelle.
- Inclusion renforcée des femmes, des seniors et des personnes en situation de handicap.
- Accompagnement à la relocalisation: logement, crèches, conseils fiscaux.
Ces mesures rendent l’attraction plus fluide et l’intégration plus durable. Elles répondent autant aux besoins des entreprises qu’aux attentes des salariés, qui cherchent stabilité, reconnaissance et progression professionnelle.
Former et fidéliser
Investir dans la montée en compétences est le meilleur amortisseur des pénuries à moyen terme. Les programmes de formation continue, les passerelles de reconversion et le mentorat accélèrent l’autonomie des nouveaux arrivants. Dans la santé et l’ingénierie, la certification ciblée offre des gains rapides en qualité et en sécurité. Elle favorise aussi la rétention, en donnant des perspectives de carrière claires.
« Il est crucial d’assurer que les travailleurs étrangers acquièrent les compétences nécessaires pour répondre aux exigences du marché suisse », souligne un dirigeant d’entreprise médicale. Cette approche crée un cercle vertueux où l’investissement en formation nourrit la productivité et l’engagement.
Une attractivité à entretenir
Les salaires restent un puissant aimant, mais ils ne suffisent plus face à la concurrence internationale. Le coût de la vie, les trajets, la disponibilité de logements et la flexibilité horaires pèsent dans la décision des candidats. Les employeurs qui soignent l’onboarding, le télétravail maîtrisé et les avantages familiaux se démarquent durablement.
Les voisins améliorent leurs offres, ce qui impose un effort constant d’attractivité. Maintenir des conditions de travail exemplaires, des équipes diverses et un management respectueux reste une stratégie autant éthique que performante. La marque employeur ne se décrète pas, elle se construit dans la durée.
Vers un pacte d’ouverture pragmatique
La réponse à la pénurie ne tient ni à un seul outil ni à un seul acteur. Elle exige un pacte entre Confédération, cantons, entreprises et syndicats, articulant ouverture maîtrisée, formation et inclusion interne. En simplifiant la reconnaissance des diplômes, en réduisant la bureaucratie et en soutenant la formation, la Suisse sécurise sa prospérité future.
Attirer, accueillir et faire grandir des talents venus d’ailleurs constitue un choix de pragmatisme et de confiance mutuelle. C’est aussi la meilleure garantie de maintenir un marché du travail innovant, capable d’absorber les chocs et de saisir les opportunités globales. En misant sur l’ouverture, le pays transforme une contrainte en avantage compétitif.