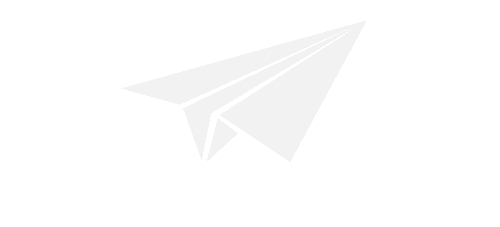Pour Selim, octogénaire discret et ancien commerçant de Saint-Ouen, la reprise de son immeuble n’a pas rimé avec délivrance mais avec une addition vertigineuse. Après l’expulsion d’occupants illégaux, il a découvert une dette d’eau proche de l’irréel, frôlant les 100 000 euros. Une histoire à la fois intime et emblématique d’un casse-tête administratif et humain.
Un immeuble transformé, une vie chamboulée
Pendant des années, son bien a été envahi par des squatteurs, laissant derrière eux désordre et dégradation. Les couloirs autrefois entretenus se sont mués en lieux hostiles, jonchés de matelas usés et de sacs d’ordures. Pour Selim, chaque porte forcée était aussi une blessure morale.
Une déferlante d’eau et des négligences fatales
Le plus saisissant demeure la consommation d’eau hors norme observée sur place. Des robinets auraient été laissés ouverts en continu, transformant la cage d’escalier en couloir d’« eau perdue ». Un agent de Veolia aurait refusé d’entrer, décrivant un sol gorgé d’humidité et des nuisibles proliférants.
Goutte après goutte, l’immeuble est devenu une saignée financière. Le compteur, impassible, a additionné des mètres cubes jamais utilisés par le propriétaire. Au bout du cycle, c’est une facture astronomique qui a surgi, sans amortisseur possible.
La facture abyssale et l’angle mort des assurances
Lorsque le calme est revenu, Selim a découvert l’addition : près de 100 000 euros pour de l’eau partie au caniveau. Côté assurances, la douche a été froide, les contrats classiques comme chez Axa excluant les dommages liés à une occupation illégale. L’effet est doublement injuste pour un propriétaire qui n’a pas consommé une seule goutte.
« Je me retrouve à payer pour des litres que je n’ai jamais consommés », souffle Selim, la voix lasse mais debout. Son avocat, Maître Xavier Bouillot, pointe un système où la lenteur des procédures aggrave le préjudice.
Quels leviers quand l’eau déborde les comptes ?
Face à pareille situation, les marges de manœuvre existent, mais restent fragiles. Une demande de dégrèvement peut être adressée au distributeur, mais elle reste incertaine dès lors que la cause n’est pas une fuite « involontaire » au sens du règlement. Le signalement pénal et la constitution de preuves par huissier deviennent alors essentiels.
- Faire constater les dégâts et les volumes par un professionnel assermenté.
- Saisir rapidement le distributeur d’eau (Veolia, etc.) et demander l’examen du dossier.
- Vérifier les clauses d’assurance et solliciter un avis juridique indépendant.
- Couper ou restreindre l’accès au réseau lorsqu’un logement est vacant, dans le respect des règles.
- Installer une télésurveillance ou des capteurs de fuite avec alertes en temps réel.
La FNAIM recommande, pour les biens sensibles, des dispositifs préventifs et des visites régulières. Une politique de « veille » technique et juridique coûte peu au regard des montants pouvant être atteints en l’absence de contrôle.
La lenteur des procédures au banc des accusés
Entre dépôt de plainte, référé, et mise en œuvre de l’ordonnance d’expulsion, les délais s’étirent, et les factures gonflent. Malgré le durcissement législatif contre les occupations illicites, l’exécution sur le terrain reste souvent laborieuse. Dans l’intervalle, c’est le propriétaire qui supporte les coûts, sans usage ni bénéfice.
Ces situations interrogent l’équilibre entre droit au logement et protection du droit de propriété. Elles soulignent l’urgence de procédures plus fluides, pour éviter que l’inaction forcée ne se traduise en ruines financières.
Un avertissement pour tous les propriétaires
L’histoire de Selim illustre un risque souvent sous-estimé par les bailleurs particuliers. Un immeuble laissé sans surveillance devient la cible idéale d’occupations et de dégradations coûteuses. La prévention, loin d’être accessoire, s’impose comme une assurance de dernier recours.
Au-delà du choc, ce dossier appelle à des mécanismes de solidarité et à des réponses plus rapides des acteurs publics et privés. Protéger son patrimoine n’est pas seulement une affaire d’acte notarié : c’est un exercice permanent de vigilance, fait d’anticipation et de réflexes.
À Saint-Ouen, Selim reconstruit pas à pas, avec la patience des bâtisseurs et la prudence des gens échaudés. Son histoire rappelle, avec force, qu’une simple fuite peut emporter bien plus que de l’eau : elle peut aussi engloutir des années d’efforts et de mémoire.